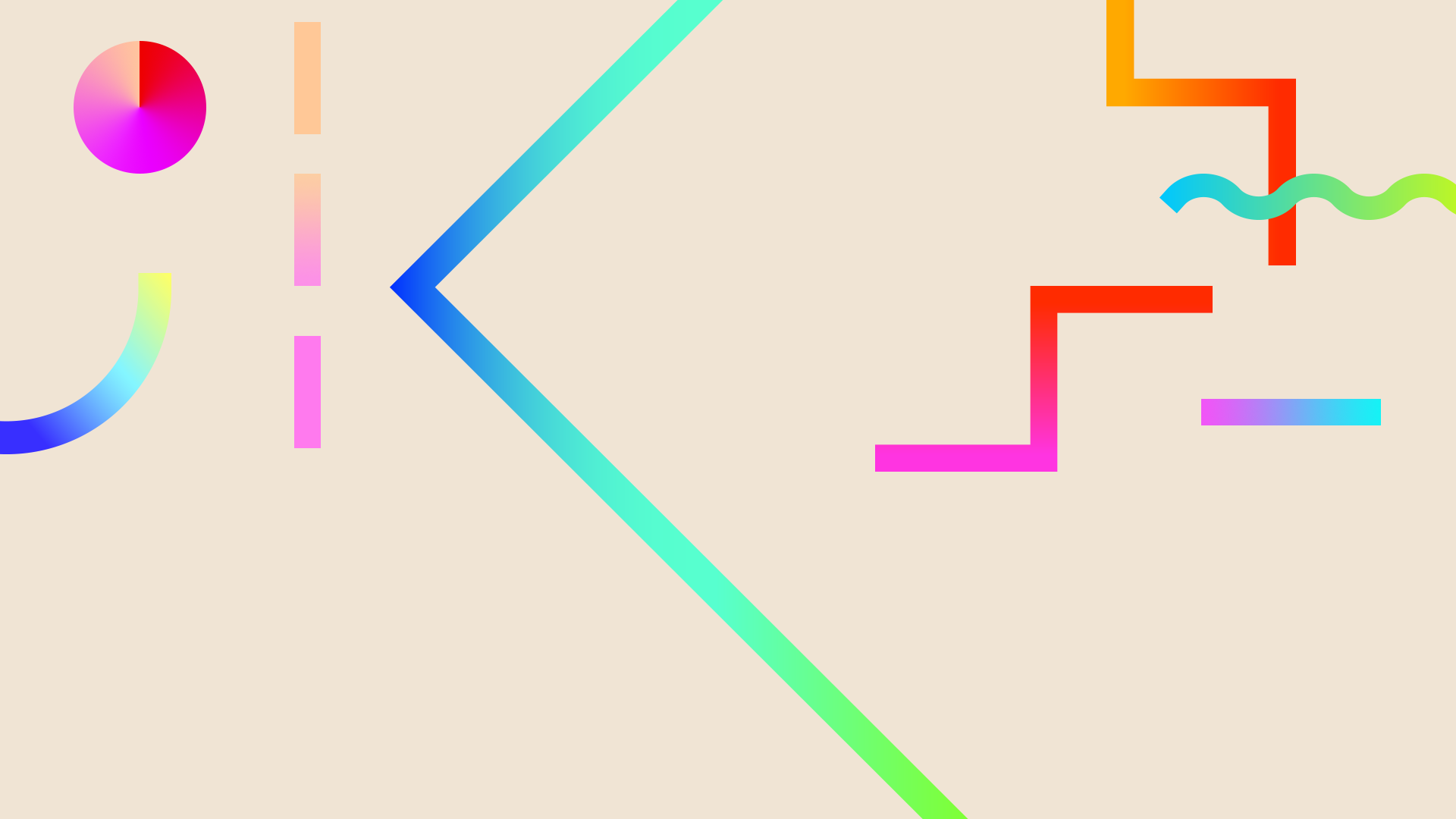
CHÂTILLON
Église de la Nativité Notre-Dame (XIIIe-XIXe siècle)
A l’origine, cette église fut dédiée à St. Sulpice, et jusqu’au XVIIIe siècle de nombreux Châtillonnais portaient en prénom celui de leur saint patron. Elle fut reconsacrée au milieu du XVIIIe siècle à Notre-Dame en sa nativité. Le grand retable de Jean Gerdolle (1745) du fond du chœur, et la toile qu’il enserre, furent commandés, sculptés peints et posés à cette occasion, qui fut marquée par une grande fête de dédicace.
On peut dater la construction initiale du premier quart du XIIIe siècle. Le chœur à chevet plat éclairé par 3 fenêtres percées dans le mur oriental, et bouchées depuis plusieurs siècles, témoigne d’une influence cistercienne (chevet semblable à Morimond et d’autres abbayes). Cette primitive église était d’un gothique sobre, même si les chapiteaux qui l’ornaient, dont deux demeurent en place au niveau du chœur et deux ont été posés sur le mur d’entrée du cimetière actuel, témoignent d’influences romanes. Il n’est pas impossible qu’il y ait eu un sanctuaire avant le XIIIe siècle. Sur le flanc gauche de la nef, une grande chapelle dédiée à St. Georges fut ajoutée au vaisseau unique, et on pouvait y accéder directement par le cimetière. Un chapelain, souvent d’origine nobiliaire, y officiait et y percevait les revenus qui y étaient affectés. Le souvenir de cette chapelle demeure dans le petit ensemble de peintures en provenant, et qui représentent St. Georges, St. Nicolas, St. Jean-Baptiste avec deux donateurs, St. Sulpice et St. André, patron de la Bourgogne. Ces tableaux ont été tirés du grenier de la cure, donc de l’oubli, et installés au fond du bas-côté droit par l’abbé Bomont au XXe siècle. Cet ensemble pictural peut être daté du début du XVIIe siècle
Il ne faut pas oublier que jusqu’en 1789 Châtillon relevait de l’archidiocèse de Besançon et que ses curés, parfois nobles eux aussi, étaient souvent d’origine comtoise. A la fin du XVe siècle, l’église fut dévastée au niveau de la nef : les troupes du Téméraire et du Sire de Valengin-Bauffremont ne l’épargnèrent pas, et les dégâts de 1476 et 1484 furent longs à être réparés. Au début du XVIe siècle, la nef fut quasiment rebâtie : en témoigne la longue inscription latine qui, en 1849, a été réinsérée dans le mur sud de la nef (visible à l’extérieur, dans le jardin – à l’origine, elle était non loin de l’escalier qui montait aux cloches) et qui dit avec emphase et soulagement que le « cruel Mars s’est tu » et que la « riche Cérès », dispensatrice du blé et des nourritures terrestres, allait pouvoir reprendre sa place et ses droits : vains espoirs ! La Guerre de Trente Ans semble avoir épargné l’édifice et son petit clocher en bâtière surmontant la croisée du transept. Un dessin de la fille du maréchal Oudinot nous en donne un bel aperçu à la veille de la grande reconstruction de 1847-1851.
Après que le clocher menaçant ruine eut été rasé en 1843, et que la nef eut été jugée trop petite et en mauvais état, une grande campagne de reconstruction s’ouvrit (1847-1851) et aboutit au résultat actuel : une nef en néo-gothique, un clocher rectangulaire surmonté d’une toiture à flèche, un portail dont les chapiteaux ne sont présentement ni façonnés ni achevés. Le financement fut coûteux, et les habitants participèrent largement aux travaux. L’entrepreneur Parent fut le maître d’ouvrage de cette campagne de travaux, avant de partir pour l’Uruguay où il finit ses jours.
Figure SEQ Figure \* ARABIC 1
Ce qui rend cette église digne d’intérêt réside dans son mobilier, ses statues (une Vierge à l’enfant du XIVe siècle au bout du bas-côté nord (classée MH), son grand retable de Gerdolle daté de 1745, une merveille de sculpture sur bois avec colonnes torses, tournesols, pampres et grappes de raisin sculptés, son Christ en ivoire offert par Stanislas à se filleule de Lambertye (tous deux classés MH), et ses toiles proches du chœur et dans les bas-côtés. Ce qui pousse aussi à visiter l’intérieur, est l’ensemble de vitraux dus à des ateliers lorrains, notamment les ateliers Benoit. Les vitraux figuratifs ou historiés représentent les principaux saints, et également quelques personnages ou scènes dignes de mémoire : Un médaillon à l’abbé Senille, qui poussa à la reconstruction son église, les combats de Notre-Dame de Lorette (1915), et surtout un saint Jean sous les traits de Jean-Mermoz, surmonté en médaillon de l’avion-cercueil appelé la « croix du sud » et dans lequel l’aviateur disparut au-dessus de l’Atlantique en 1936. Il s’agit d’un cadeau d’officiers de l’air basés à Luxeuil, bouleversés par la disparition de leur héros et ami. Les plus beaux vitraux sont en fait ceux qui éclairent le chœur et l’entrée principale (de part et d’autre de la tribune surmontant la porte) : des chefs d’œuvre de l’art déco qu’il faut voir au soleil levant ou couchant. Il reste peu de pierres tombales, sauf celle de la famille seigneuriale des la Charmoille, fort usée et peu visible, car partiellement cachée sous une rangée de bancs, et surtout celle de Laure de Saint-Ouen, dont le rôle et l’aura sont rappelés par une plaque fixée dans le mur. Cette grande dame, pédagogue et historienne, fut enterrée dans le cimetière voisin de l’église (1838), et sa dalle funéraire fut incluse dans le sol en 1850.
 |  |
|---|
